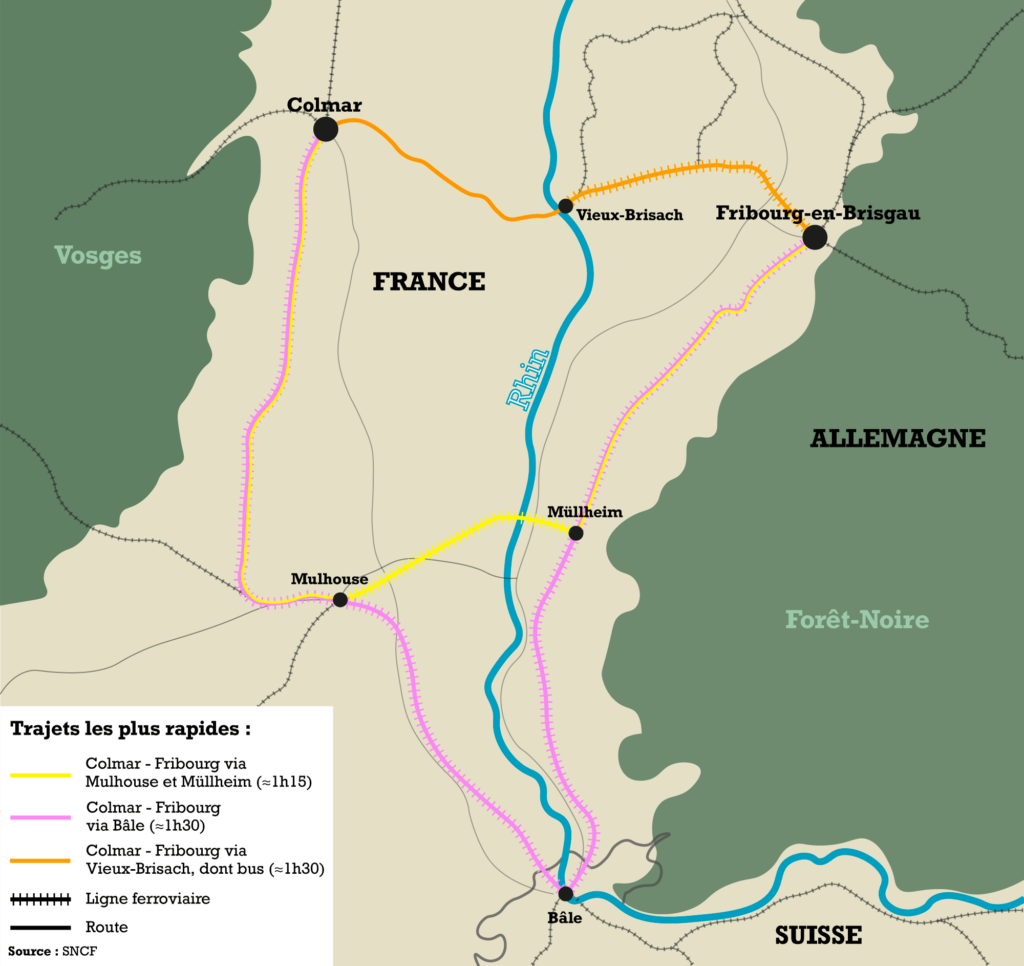En vingt ans, plusieurs lois ont assoupli les règles et causé une prolifération de machines à sous à Kehl, où la plupart des joueur·ses sont français·es. Retour en onze dates sur la bataille judiciaire de la ville contre les bandits manchots.
Abel Berthomier et Angellina Thiéblemont

Alors qu’en France, les machines à sous sont interdites, sauf dans certains emplacements comme les stations balnéaires, elles sont autorisées dans les bars et restaurants chez nos voisin·es allemand·es depuis 1950. À Kehl, accessible en tram depuis Strasbourg, elles foisonnent depuis vingt ans dans les casinos, les restaurants et bistrots, attirant de nombreux·ses Français·es qui viennent en outre y consommer tabac et alcool, moins chers outre-Rhin.
Quinze dates clés permettent de comprendre comment, à partir de 2006, ces machines ont proliféré à Kehl malgré les craintes municipales et citoyennes et plusieurs initiatives visant à limiter le tapage nocturne et l’addiction au jeu. Dans ce combat opposant la ville aux autorités régionales et fédérales, pour le moment, les machines à sous gagnent à tous les coups.
27 janvier 2006 : Une nouvelle loi allemande favorise les jeux d’argent
Le nombre de machines à sous autorisées dans les restaurants passe de deux à trois. Dans les salles de jeux, le nombre maximal d’appareils passe de dix à douze. Cette nouvelle réglementation permet aussi de proposer des gains plus élevés aux joueur·ses pour les inciter à jouer davantage. Cette mesure résulte d’un long lobbying de l’industrie allemande du jeu d’argent. Le président de l’union des machines à sous allemandes (Verband der Deutschen Automatenindustrie), Paul Gauselmann, s’en réjouit publiquement en 2007, saluant « plus de sept ans de luttes politiques et de bras de fer » en faveur d’une « libéralisation responsable du marché ». À Kehl, l’effet est quasi immédiat. « Les machines ont ensuite poussé comme des champignons », raconte la responsable de la communication de la mairie, Annette Lipowsky. Entre 2006 et 2011, le nombre de machines à sous dans les établissements de restauration de Kehl passe de 84 à 268 et de 99 à 265 pour les salles de jeux.
10 novembre 2009 : Les restaurants peuvent rester ouverts plus tard
Une modification du règlement régional sur les restaurants repousse leurs horaires de fermeture de deux à trois heures du matin en semaine et de trois à cinq heures du matin le week-end. Cela concerne aussi les établissements qui accueillent des machines à sous.
Janvier 2012 : Des Kehlois·es s’érigent contre les machines
La pétition émane du groupe citoyen Chrétiens et musulmans, elle dénonce les effets négatifs du jeu sur les familles et demande d’endiguer la prolifération des machines. Elle circule dans la majorité des commerces de la ville de 34 000 habitant·es et recueille quelque 4 600 signatures. Elle ne débouche cependant sur rien.
9 mars 2012 : La mairie de Kehl tente d’endiguer le phénomène
La mairie demande au gouvernement fédéral une réduction du nombre de machines autorisées dans les restaurants. Elle sollicite également le Land de Bade-Wurtemberg, auquel elle appartient, afin de rétablir les horaires d’avant 2009, ce qui obligerait les établissements à fermer plus tôt. Ces demandes sont motivées par la volonté de réduire les nuisances sonores occasionnées par les joueur·ses de nuit.
19 septembre 2012 : Les bistrots gagnent face à la ville
Un groupe de bistrotier·es mène une action en justice contre la ville, s’opposant à ce que leurs établissements ferment plus tôt. Le tribunal administratif leur donne raison. Il estime que la ville n’a pas fait de « constatations fiables sur la situation du bruit nocturne dans tout le champ d’application du règlement » et que « les évaluations subjectives des riverains n’étaient pas suffisantes ».
20 novembre 2012 : Une nouvelle loi épargne les machines à sous
Pour répondre aux exigences de la Commission européenne en matière de réglementation des jeux d’argent, une nouvelle loi fédérale allemande est adoptée et ensuite déclinée au niveau régional. Elle impose une distance de minimum 500 mètres entre les différentes salles de jeux afin d’en limiter le nombre et une distance minimale de 500 mètres par rapport à toute installation accueillant des mineur·es. Elle entend protéger les jeunes et les joueur·ses.

28 avril 2017 : L’extension du tram amène de nouveaux·elles client·es
Strasbourg et Kehl sont désormais reliées par le tram D. Les Strasbourgeois·es peuvent se rendre à Kehl en trente minutes et affluer plus facilement dans les salles de jeux.
10 novembre 2019 : Les restaurants doivent se limiter à deux machines
Les restaurants et bars peuvent accueillir deux machines maximum, contre trois auparavant. La ville totalise alors 671 machines à sous. « On était la ville de la région de Bade-Wurtemberg avec le plus de machines à sous : une machine à sous pour 54 habitants », précise la mairie. La mesure vise une meilleure protection des joueur·ses et un alignement sur les normes européennes.
2020 : La pandémie empêche les Français·es de jouer à Kehl
Certain·es joueur·ses français·es se reportent sur les jeux en ligne pendant la fermeture des frontières avec la pandémie de Covid-19. « À la réouverture des frontières, la plupart [des Français·es dépendant·es aux machines] sont revenus », raconte Louis-Marie D’Ussel, docteur au service d’addictologie de l’hôpital de Strasbourg. En 2022, les recettes de la taxe sur le divertissement atteignent 80 % du niveau pré-Covid.
Février 2023 : Un ancien cadre de la mairie condamné pour corruption
L’ancien chef du service de l’ordre public s’était fait promettre 50 000 euros par un exploitant de salle de jeux espérant ainsi qu’il lui accorde des autorisations d’exploitation exceptionnelle pour l’installation des casinos. Il a été condamné à 14 mois de prison avec sursis.
1er janvier 2023 : Une nouvelle autorité de régulation est opérationnelle
Une nouvelle autorité régionale de contrôle des jeux d’argent, la Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL), accorde désormais la licence aux professionnel·les qui souhaitent proposer des services de jeux d’argent. Ces personnes doivent, entre autres critères, démontrer qu’ils et elles adhèrent aux mesures de protection des joueur·ses et qu’ils et elles respectent la transparence des transactions.
Deux ans après, à Kehl, les recettes de la « taxe sur le divertissement » continuent de diminuer, année après année. Elles étaient de 3 millions d’euros en 2022, contre 6,1 millions d’euros en 2018. Pour l’élu écologiste Norbert Hense, c’est la preuve d’un impact marginal mais progressif de mesures visant à mieux réguler l’industrie du jeu.
- Au total, le Land compte au moins 30 000 personnes dépendantes au jeu, d’après une étude de l’Institut de recherche psychiatrique de Mannheim publiée le 23 décembre 2016. Parmi ces joueur·ses dépendant·es, 87 % le sont à cause des machines à sous. L’étude souligne aussi le phénomène de co-dépendance : 80 % de ces personnes sont dépendantes à la nicotine et 28 % à l’alcool.
- La clientèle qui joue à Kehl est française et précaire, constate une étude du Centre européen de la consommation publiée en mai 2019. « La population qui va jouer à Kehl est plus précaire que ceux qui jouent en France, rapporte le Dr. Louis-Marie D’Ussel, spécialiste en addictions comportementales à l’hôpital de Strasbourg. La plupart sont des consommateurs de tabac qui vont acheter leurs cigarettes à Kehl et qui, finalement, commencent à jouer là-bas, et y reviennent pour le jeu. »
- Les machines à sous rapportent 3 millions d’euros à la ville en 2022, grâce à la taxe sur le divertissement. Rapportée au nombre d’habitant·es, Kehl est la 8e ville du Bade-Wurtemberg qui récolte les recettes les plus importantes par cette taxe, alors que ce n’est que la 45e ville la plus peuplée du Land.