Les nouvelles générations alsaciennes se détournent de l’allemand. Face à ce déclin, la Collectivité met en place des politiques éducatives pour inciter les jeunes à apprendre la langue du voisin, mais sans grand succès.
Athénaïs Cornette
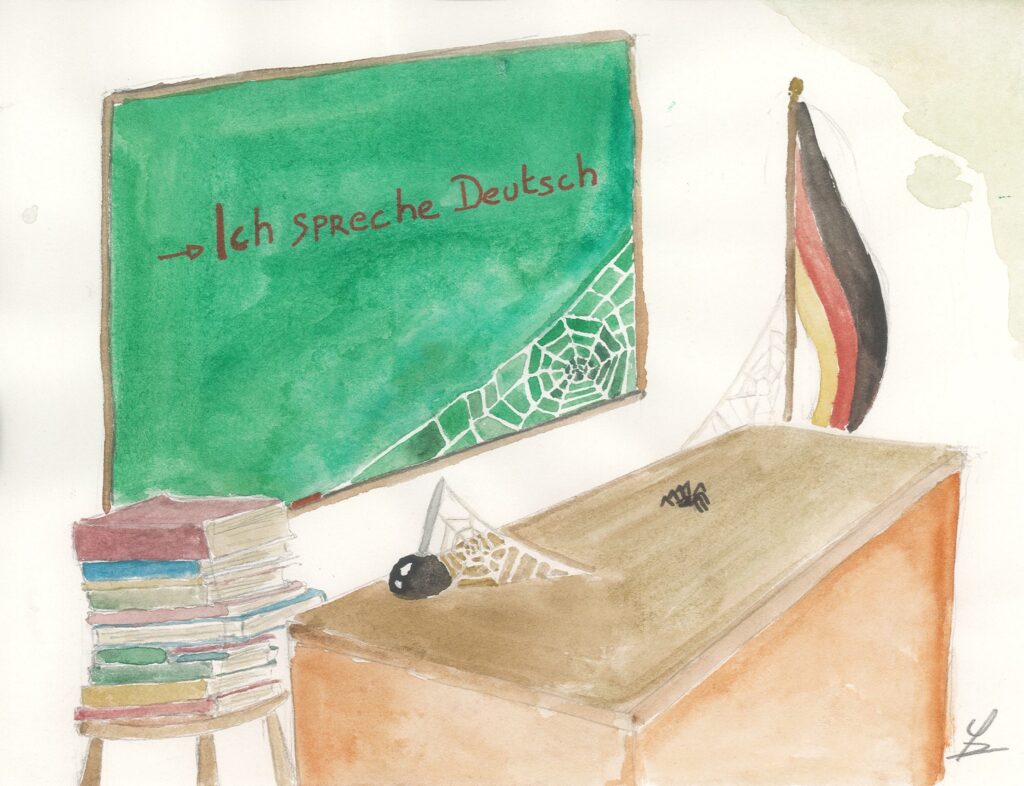
En Alsace, les jeunes délaissent l’allemand. C’est ce que révèle un sondage commandé par la Collectivité européenne d’Alsace (CEA), qui réunit les conseils départementaux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. En 2022, seulement 32 % des Alsacien·nes âgé·es de 18 à 24 ans déclaraient maîtriser la langue de Goethe, contre 55 % des 45-54 ans et 74 % des plus de 65 ans. Face à cette régression, la CEA a proclamé 2025 « l’année du bilinguisme » et organise une série d’événements culturels et éducatifs destinés à promouvoir les langues germaniques.
Mais ces initiatives s’apparentent à du « saupoudrage » pour plusieurs universitaires, qui voient leurs classes d’étudiant·es se vider d’année en année et l’intérêt général pour la culture allemande s’amoindrir. « La baisse du niveau d’allemand est d’abord liée à la faible transmission de l’alsacien dans les foyers, et donc, à une diminution des compétences germanophones », analyse Claude Froehlicher, président d’Eltern Alsace, une association qui œuvre pour le développement de ces langues.
La naissance de l’AbiBac
Pendant des décennies, sous l’Empire puis sous l’Occupation allemande, les habitant·es du Bas-Rhin communiquaient en alsacien et employaient l’allemand dans les administrations et les écoles. « La population était alphabétisée en allemand, au même titre que les autres régions germanophones, explique Pascale Erhart, maîtresse de conférence en dialectologie alsacienne à l’Université de Strasbourg. C’était la langue de l’écrit. » Mais en 1945, la réintégration de l’Alsace à l’intérieur des frontières françaises a engendré une politique de francisation, précipitant le déclin des dialectes alémaniques.

« C’était un choc, explique Pascale Erhart. Les gens ont milité pour réintégrer ces langues dans les programmes éducatifs et ça a fini par porter ses fruits. » En 1994, l’État a créé l’AbiBac, un double diplôme qui délivre le baccalauréat français et l’Abitur allemand. Strasbourg fait partie des trois premières villes à l’avoir proposé aux lycéens. Autre victoire : à partir de 1981, des cours d’allemand ont été dispensés dans les écoles primaires locales à titre dérogatoire, tandis que le reste de la France a attendu la réforme de 2002 pour autoriser l’enseignement des langues vivantes avant le collège.
« J’ai suivi des cours jusqu’au bac mais je ne sais pas parler allemand »
Quarante ans plus tard, les initiatives politiques pour encourager le plurilinguisme persistent et la région connaît des succès. « Avec le rectorat et l’Éducation nationale, la Collectivité verse des bourses aux étudiant·es qui préparent le Capes [concours pour enseigner dans les collèges et les lycées, ndlr] et finance les projets franco-allemands des classes du primaire et du secondaire, explique Marie-Laure Vraux, cheffe de projet bilinguisme à la CEA. Aujourd’hui, Strasbourg est la ville qui comporte le plus de lycées proposant une section AbiBac, d’après le ministère de l’Éducation, avec 18 établissements contre seulement trois à Paris. Et selon l’Académie de Strasbourg, 83,1 % des élèves de 6e de la ville étudient l’allemand, contre 14,6 % à l’échelle nationale.
Pourtant, à la sortie du lycée, peu d’entre eux poursuivent leur apprentissage. C’est notamment le cas d’Armand, 26 ans. Né à Strasbourg, il travaille aujourd’hui dans l’hôtellerie et a arrêté l’allemand après le lycée, comme l’intégralité de ses amis. « J’ai suivi des cours jusqu’au bac, mais je n’ai jamais su parler. J’ai mis tous mes efforts dans l’apprentissage de l’anglais, que j’utilise pour communiquer avec les client·es germanophones, on se comprend toujours très bien. »
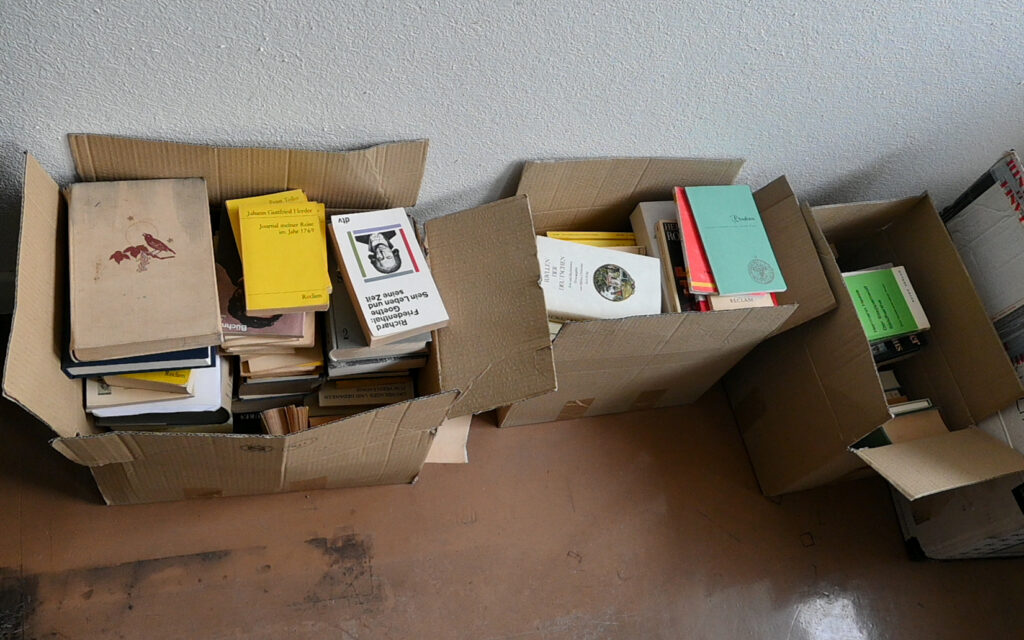
Pour Pierre Klein, directeur de la Fédération Alsace Bilingue, si les élèves abandonnent l’allemand, c’est parce que les professeur·es de la région ne mettent pas suffisamment l’accent sur l’histoire régionale de la langue. Dans un communiqué publié en novembre 2023, il écrivait : « Qu’il s’agisse de l’école élémentaire, du collège, du lycée ou de l’université, l’allemand est largement enseigné en Alsace comme il l’est à Bordeaux ou à Périgueux, comme une langue hors sol ou étrangère. »
Une opinion partagée par Pascale Erhart : « Cela fait 40 ans qu’on ne fait pas le lien entre ce qui est parlé dans la région par une partie de la population, l’alsacien, et ce qui est enseigné à l’école, observe l’universitaire. Les gens ne savent plus pour quelles raisons ils apprennent l’allemand. » Autrement dit, les professeur·es se concentrent sur l’enseignement de la grammaire et négligent la dimension historique et culturelle de la langue, qui n’est pas uniquement celle du voisin.
Les professeur·es d’allemand manquent à l’appel
Aurélie Le Née, co-directrice du département d’études allemandes à l’Université de Strasbourg, a aussi observé la diminution du nombre d’étudiant·es dans son cursus. L’enseignante, qui forme au concours du Capes, s’est installée dans la capitale alsacienne en 2019. « Quand je suis arrivée, j’enseignais à trois classes, aujourd’hui je n’en ai plus qu’une seule », raconte-t-elle. Et les chiffres semblent aller dans son sens. D’après les données officielles du Capes, chaque année des postes d’enseignant·es restent vacants. En 2024 par exemple, pour 165 places disponibles, 109 candidats ont passé l’écrit du Capes et 75 ont été admis.
Un déficit qui s’explique notamment par des conditions de travail peu attractives. « Les classes d’allemand étant de moins en moins nombreuses, les professeur·es doivent souvent travailler dans plusieurs écoles, explique Aurélie Le Née. Cela entraîne un tas de complications : il faut se déplacer facilement, se sentir intégré dans différents établissements… »
Par ailleurs, le risque d’être envoyé dans une autre région expose davantage l’Alsace au risque de pénurie de professeur·es. « À partir du moment où un étudiant réussit son Capes, peu importe sa matière, il peut être affecté aux quatre coins de la France, explique Sabine Ischia, chargée du développement du bilinguisme au sein de la Collectivité. La vision du ministère est qu’un enfant a le droit d’apprendre l’allemand, qu’il habite en Alsace ou ailleurs. »
Mais le jeu des mutations pèse sur le lien spécial qu’entretient l’Alsace avec l’allemand. Lorsque les professeur·es ne sont pas lié·es à cette histoire régionale, la dimension historique et culturelle de la langue est davantage occultée par ces dernier·es.
